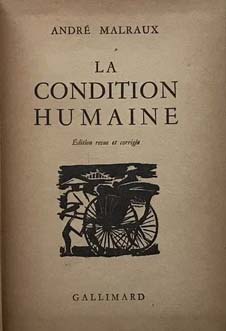
Paul Gosselin (15/11/2025)
Curieux ce roman. Puisque ce récit par André Malraux se déroule dans le contexte de la guerre sino-japonaise et des conflits entre les communistes de Mao et de la République chinoise de Tchang Kaï-Chek, on pourrait s’attendre à un récit plutôt politique. On pourrait s'attendre à des discours sur l'oppression du prolétariat, mais il n’en est rien. Toute l’attention de Malraux porte sur la psychologie des personnages et des motifs qui les font agir (pour tuer, se faire tuer et donner sens à leurs vies) au milieu de tous ces conflits. Le récit commence même par un assassinat. Par moments on dirait une psychanalyse de l’action politique et possiblement une critique subliminale du communisme, pourtant au sommet de son prestige[1] à l’époque. Voici un bon exemple de la réflexion d’un des personnages (1946 : 153-154)
« Pourquoi vous battez-vous? »... Sa femme, son gosse, il les empêchait de mourir. Ce n’est rien. Moins que rien. S’il avait possédé de l’argent, s’il avait pu le leur laisser, il eût été libre de se faire tuer. Comme si l’univers ne l’eût pas traité, tout le long de sa vie, à coups de pied dans le ventre, il le spoliait de la seule dignité qu’il possédât, qu’il pût posséder - sa mort. Respirant avec la révolte de toutes choses vivantes, malgré l’habitude, l’odeur des cadavres que chaque bouffée de vent passait glisser sur le soleil immobile, il s’en pénétrait avec une horreur satisfaite...
Ailleurs, on dirait que Malraux reprend le concept Nietschzien du Surhomme/Ubermensch, tout en l’exprimant avec une ironie qui lui est propre (1946 : 192)
... les hommes sont peut-être indifférents au pouvoir... Ce qui les fascine dans cette idée, voyez-vous, ce n'est pas le pouvoir réel, c'est l'illusion du bon plaisir. Le pouvoir du roi, c'est de gouverner, n'est-ce pas ? Mais l'homme n'a pas envie de gouverner : il a envie de contraindre, vous l'avez dit. D'être plus qu'un homme dans un monde d'hommes. Échapper à la condition humaine, vous disais-je. Non pas puissant : tout-puissant. La maladie chimérique, dont la volonté de puissance n'est que la justification intellectuelle, c'est la volonté de déité : tout homme rêve d'être dieu.
Vers la fin, Malraux médite sur le vide, le vide de sens[2], qui confronte l’homme moderne, cet animal qui est le produit final et l'aboutissement logique des Lumières. (1946 : 284):
On peut tromper la vie longtemps, mais elle finit toujours par faire de nous ce que pour quoi nous sommes faits. Tout vieillard est un aveu, allez, et si tant de vieillesses sont vides, c'est que tant d'hommes l'étaient et le cachaient. Mais cela même est sans importance. Il faudrait que les hommes pussent savoir qu'il n'y a pas de réel, qu'il est des mondes de contemplation - avec ou sans opium - où tout est vain...
Et le même problème se pose pour le communisme, système idéologico-religieux qui n'a à proposer qu'un mince paradis (politique) comparable à un mirage, qui s'éloigne dès qu'on s'en marche vers lui... Comme le note Malraux, chez certains ce vide existentiel pousse vers le néant. Le personnage Grisors exprime cette tentation de la manière suivante (1946 : 285)
Libéré de tout, même d'être homme, il caressait avec reconnaissance le tuyau de sa pipe [à opium], contemplant l'agitation de tous ces êtres inconnus qui marchaient vers la mort dans l'éblouissant soleil, chacun choyant au plus secret de soi-même son parasite meurtrier. “ Tout homme est fou, pensa-t-il encore, mais qu'est une destinée humaine sinon une vie d'efforts pour unir ce fou et l'univers... ”
Il faut noter que Malraux semble vaguement conscient que le vide existentiel a des répercussions pour la question morale, et à la fin, sur tout l’édifice du droit. Dans un article publié dans L'Express, il propose les observations qui suivent au sujet du problème moral dans le contexte matérialiste/évolutionniste (Malraux 1955 : 15):
L'homme ne se construit qu'en poursuivant ce qui le dépasse, mais c’est ce dépassement qu’il s’agit d’expliquer. [...] toute la civilisation moderne [...] a substitué un fantôme aux profondes notions de l'homme qu'avaient élaborées les grandes religions. Chacune de celles-ci rendait compte à sa manière de la grandeur humaine. La science[3], non (...) Le drame de la civilisation du siècle des machines n'est pas d'avoir perdu les dieux, car elle les a perdus moins qu'on ne le dit: c'est d'avoir perdu toute notion profonde de l'homme. (...) Depuis cinquante ans, la psychologie réintègre les démons dans l'homme. Tel est le bilan sérieux de la psychanalyse. Je pense que la tâche du prochain siècle, en face de la plus terrible menace qu'ait connue l'humanité, va être d'y réintégrer les dieux.
Mais quel lapsus. N’est-ce pas un aveu (inconscient) de l’échec des Lumières ? Mais bon, quel intellectuel français l’admettrait explicitement ??

CAMUS, Albert (1942) Le Mythe de Sisyphe: essai sur l'absurde. Éditions Gallimard [Paris] [Essais 11, Bibliothèque de la Pléiade] 187 p.
MALRAUX, André (1933/1946) La Condition humaine. [édition revue et corrigée] Gallimard Paris 287 p.
MALRAUX, André (1955)
L’homme et le fantôme. p. 15 L'Express 21 mai
[1] - Le journaliste britannique Malcom Muggeridge avait offert un écho du Holdomor initié par Staline. Et longtemps après viendra l’Archipel du Goulag par Soljénitsyne (1973), mais les croyants qui avaient une foi ferme en Marx ont longtemps ignorer ces faits... Détail qui concorde avec un aspect de la définition biblique de la foi : « Or la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas. ”» (Heb 11: 1)
[2] - Fort probable que ce soit la même question qui a provoqué cette boutade impitoyable de Camus (1942: 99):
Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux: c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a trois dimensions, si l'esprit a neuf ou douze catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux; il faut d'abord répondre.
[3] -
Ou, plus précisément le dogme du matérialisme. Dogme
qu’aucun des fondateurs de la science, les Galilée, Kepler, Newton,
Blaise Pascal, Carl von Linnée, etc. n’a partagé.