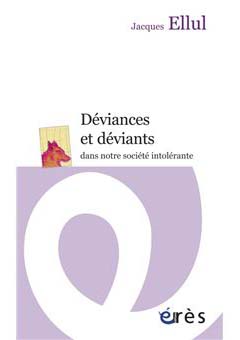 Paul Gosselin (3/11/2025)
Paul Gosselin (3/11/2025)
Voici un livre curieux par le philosophe et sociologue français Jacques Ellul, un livre souvent utile, mais parfois perdu dans les nuances et sans prise sur la réalité sociale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Ellul fit partie de la Résistance à l'occupation Allemande.
Voici un exemple de l'utile. Discutant des pressions sociales en direction du conformisme, sans faire exprès, Ellul décrit les régimes succombant à la tentation totalitaire (1992/2000: 28)
Dans un tout autre contexte, n'y aurait-il pas déviance dans des sociétés à l'inverse organisées à l'extrême, absorbant l'individu, rigoureuses quant à la conformité des “ comportements ” ? Autrement dit la formulation de normes sociales de conduites très strictes n'est-elle pas productrice de marginaux qui ne peuvent pas les suivre ?
En somme les États succombant à la tentation totalitaire génèrent la déviance, mais Ellul ne semble pas considérer que ces sociétés peuvent produire des marginaux qui ne veulent pas suivre les directives d'un régime néo-totalitaire ou qui rejettent le code moral de ce régime (tout comme les résistants de Chambon-sur-Lignon qui ont hébergé des Juifs sous l'Occupation). Mais il est ironique qu'ailleurs dans ce texte Ellul nous offre un clin d'oeil de la vie sous un régime où le pouvoir de contrôle de l'État sur la vie de l'individu n'est pas total. Dans la citation qui suit, Ellul relate des souvenirs d'enfance d'une époque que nos élites désignent inévitablement le “ règne du patriarcat oppressif ” (1992/2000).
Il suffit pour un homme de mon âge de rassembler des souvenirs d'enfance pour mesurer l'incroyable distance existant entre la vie que je pouvais mener en tant qu'enfant et les impossibilités auxquelles se heurtent les jeunes aujourd'hui. Il n'y avait pratiquement pas de police, et nous ne sentions peser aucun carcan d'obligations et d'interdits. (p. 81)
Je ne dis pas que nous avions du bien-être. Je dis que régnait une absence de contraintes même pour les pauvres, et une possibilité d'initiative individuelle, de choix (je répète et je sais ce que je dis: même pour les pauvres) qui nous donnait un bonheur que je ne revois plus. Sans doute, nous gelions l'hiver parce qu'il n'y avait pas de chauffage. Avoir l'eau courante et le gaz était un luxe tel qu'il était indiqué par une plaque sur les immeubles qui en étaient dotés. On marchait: ... à 13 ans, j'allais quatre fois par jour de mon domicile au lycée, il y avait un peu plus de 3 kilomètres: je faisais près de quinze kilomètres à pied par jour. Je m'en portais très bien. Mais nous avions une capacité de jeux et d'inventions que je ne trouve plus chez les jeunes. Possédant tout, ils ne cessent de s'ennuyer. (p. 82)
En écrivant ces souvenirs, je n'exprime en rien le regret traditionnel du temps de ma jeunesse. Je dis une chose très simple, c'est que dans la dureté de ces temps (que j'ai mieux connue que beaucoup de ceux qui en font la peinture noire), il y avait plus d'indépendance individuelle, moins de marginalité, moins de déviance (je ne dis pas moins de délinquance), moins de quadrillage administratif, moins de contrôle social qu'aujourd'hui. En que l'exercice d'une action individuelle avait un sens en même temps qu'elle était possible. Nous étions au tournant de la société traditionnelle et la société moderne. (pp. 85-86)
Ne serait-ce pas impensable que si le patriarcat est si détesté des postmodernes ce soit qu'au fond le patriarcat constitue un lieu de liberté et un obstacle au pouvoir de l'État Total?... Discutant d'un thème qui touche les comportements de nombreux États occidentaux lors de la crise du Covid, Ellul examine le concept de l'intérêt général[1] et dresse un portrait intéressant de son utilisation dans la propagande d'État (1992/2000).
Avec l'idéologie de l'intérêt général, on a eu une extension de cette miraculeuse concordance à tous les domaines et en particulier au domaine politique. Or, tandis qu'en économie la convergence était laissée au mécanisme lui-même, en politique, l'intérêt général a trouvé son point d'incarnation, à savoir l'État. Il y a coïncidence des mécanismes de légitimation autour et au profit de l'État qui devient le “ principe de totalisation ”. (...) L'idéologie de l'intérêt général n'est pas une simple justification du pouvoir politique elle en est le ressort. C'est parce qu'il y a (vraiment) un intérét général que l'État prend les décisions qui concernent tout le monde et permettent la mobilisation de tout le monde. Mais il faut que tous, en effet, reconnaissent cet intérêt ! (pp. 76-77)
À la fin, Ellul reconnaît implicitement la possibilité que le concept de l'intérêt général puisse servir à des fins de propagande (totalitaire) (1992/2000: 77-78):
“ L'intérêt général n'est pas réductible à la somme des intérêts particuliers ”, et c'est pourquoi il est à la fois si difficile de savoir où se logent les divers intérêts particuliers, et si facile de les exclure au nom d'un intérêt général qui n'en exprime aucun, mais les transcende tous. (... )
L'institution étatique permet de retrouver l'unité perdue et le grand UN devient objet d'amour. ” Et, en l'espèce actuelle, ce qui est de l'ordre de l'État est devenu de l'ordre de l'administration. Ce que décide l'administration est l'intérêt général.
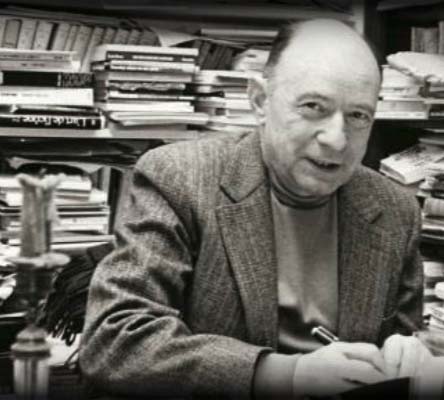 Au chapitre 3, Ellul émet un commentaire très utile (en note en bas de page) sur la logique eugéniste (comparable au concept des Unnütze Esser / mangeurs inutiles[2] des eugénistes nazis) (1992/2000: 103):
Au chapitre 3, Ellul émet un commentaire très utile (en note en bas de page) sur la logique eugéniste (comparable au concept des Unnütze Esser / mangeurs inutiles[2] des eugénistes nazis) (1992/2000: 103):
On peut faire une remarque intéressante sur le rapport individu/société qui ressort au XIe congrès du Centre International de Gérontologie (août 1980). Les médecins, biologistes, psychologues sont assez confiants quand aux possibilités de l'être humain à s'adapter aux limites et aux contraintes du vieillissement, alors que les sociologues, économistes et démographes sont beaucoup moins sereins et optimistes quant aux possibilités des sociétés pour supporter le vieillissement moyen, et généralisé de la population. La société tendra à rejeter, marginaliser de plus en plus les vieux ; la société supporte moins bien le vieillissement que l'être humain.
Ouais, "La société"... ne faut-il pas dire plutôt "certaines élites", par exemple, les membres de la secte de Davos qui aiment bien déclarer qu'il y a trop d'humains sur la terre? Évidemment, eux, ils ne sont pas de trop...
Touchant la fuite d'Ellul dans les nuances, vers la conclusion, Ellul clame réduire le phénomène de la déviance en promulguant de “nouvelles valeurs”, particulièrement dans le système juridique. Mais il néglige de préciser ce que sont ces “nouvelles valeurs” et de quel système idéologico-religieux il les tire[3]... Si l'intellectuel français typique ne peut concevoir affirmer ouvertement un code moral ouvertement religieux, cela le repousse inévitablement dans des banalités et dans un cul-de-sac argumentaire.
Lorsqu'un dévot des Lumières veut se donner des "airs moraux", il récupère, plus ou moins sciemment, les prescriptions morales tirées de la vision du monde judéo-chrétienne. Chez les intellectuels français, les aveux de ce genre sont très exceptionnels, mais voici un exemple tiré d'un échange entre Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir (1981: 552)
S. - de B. - Comment définiriez-vous en gros votre Bien et votre Mal, ce que vous appelez le Bien, ce que vous appelez le Mal?
J.-P. S. - Essentiellement le Bien c'est ce qui sert la liberté humaine, ce qui lui permet de poser des objets qu'elle a réalisés, et le Mal c'est ce qui dessert la liberté humaine, c'est ce qui présente l'homme comme n'étant pas libre, qui crée par exemple le déterminisme des sociologues d'une certaine époque.
S. de B. - Donc, votre morale est basée sur l'homme et n'a plus beaucoup de rapport avec Dieu.
J.-P. S. - Aucun, maintenant. Mais il est certain que les notions de Bien et de Mal absolus sont nées du catéchisme qu'on m'a enseigné.
On a devant nous un cas flagrant de parasitisme éthique, mais Sartre est tout de même un rare cas à l'AVOUER (mais dans une conversation qu'il croyait intime, plutôt que dans un truc qu'il aurait publié lui-même ?)... Par contre Nietzsche a TRES bien compris l'hypocrisie et l'incohérence d'un tel parasitisme éthique. Dans sa génération, Nietzsche, un des philosophes les plus clairvoyants du XIXe siècle, a remis en question le concept que l'on puisse tirer l'éthique du néant, comme le magicien tire un lapin de son chapeau. Discutant des matérialistes incohérents de sa génération, il a exprimé des commentaires décapants qui donnent à réfléchir sur l'exercice difficile de la cohérence dans le cadre conceptuel matérialiste issu des Lumières (1899/1970: 78-79):
Ils se sont débarrassés du Dieu chrétien et ils croient maintenant, avec plus de raison encore devoir retenir la morale chrétienne. C'est là une déduction anglaise, nous ne voulons pas en blâmer les femelles morales à la Eliot. En Angleterre, pour la moindre petite émancipation de la théologie, il faut se remettre en honneur, jusqu'à inspirer l'épouvante, comme fanatique de la morale. C'est là-bas une façon de faire pénitence. Pour nous autres, il en est autrement. Si l'on renonce à la foi chrétienne, on s'enlève du même coup le droit à la morale chrétienne. (...) Si les Anglais croient en effet savoir par eux-mêmes, “ intuitivement ” ce qui est bien et mal, s'ils se figurent, par conséquent, ne pas avoir besoin du christianisme comme garantie de la morale, cela n'est en soi-même que la conséquence de la souveraineté de l'évolution chrétienne et une expression de la force et de la profondeur de cette souveraineté: en sorte que l'origine de la morale anglaise a été oubliée, en sorte que l'extrême dépendance de son droit à exister n'est plus ressentie. Pour l'Anglais, la Morale n'est pas encore un problème.
Nietzsche parlait parfois de danser au bord de l'Abîme (il me semble légitime de penser que le marquis de Sade a fait justement plus que danser au bord). Là où Nietzsche a jeté un coup d'oeil précautionneux, Sade a sauté à pleins pieds... Mais vivre de manière cohérente avec sa vision du monde n'est pas toujours facile...
BEAUVOIR, S. de (1981/1974) La cérémonie des adieux; suivi de Entretiens avec Jean-Paul Sartre, août-septembre. [Paris]: Gallimard, 559 p.
ELLUL, Jacques (1992/2000) Déviances et déviants dans notre société intolérante. [préface de Jean-Luc Porquet] Érées éditions Toulouse (coll. Sociétés) 209 p.
GOSSELIN, Paul (2010) Moral Absolutes: An Exchange with Atheist Paul Baird and Paul Gosselin. (Samizdat – 23/11/2010)
NIETZSCHE, Friedrich (1899/1970) Crépuscule des idoles; suivi de Le cas Wagner. (trad. d'Henri et, al. Médiations ; 68) Denoël Gonthier Paris 190 p.
[1] - Concept équivalent à l'expression plus connue : bien commun.
[2] - Concept appliqué par le programme Aktion T4.
[3] - Question discutée lors de de mon échange avec l'athée britannique Paul Baird. Cf références.